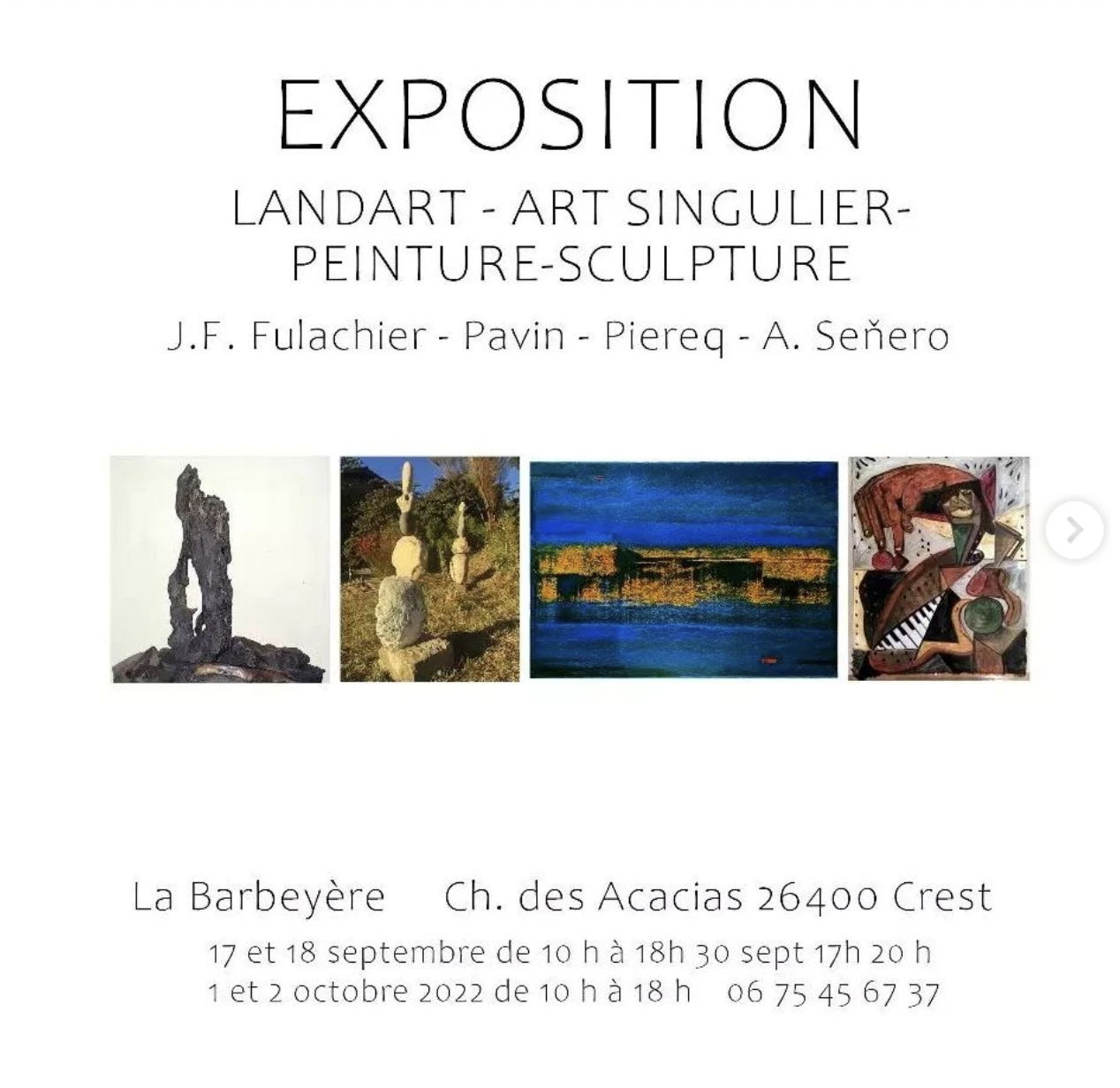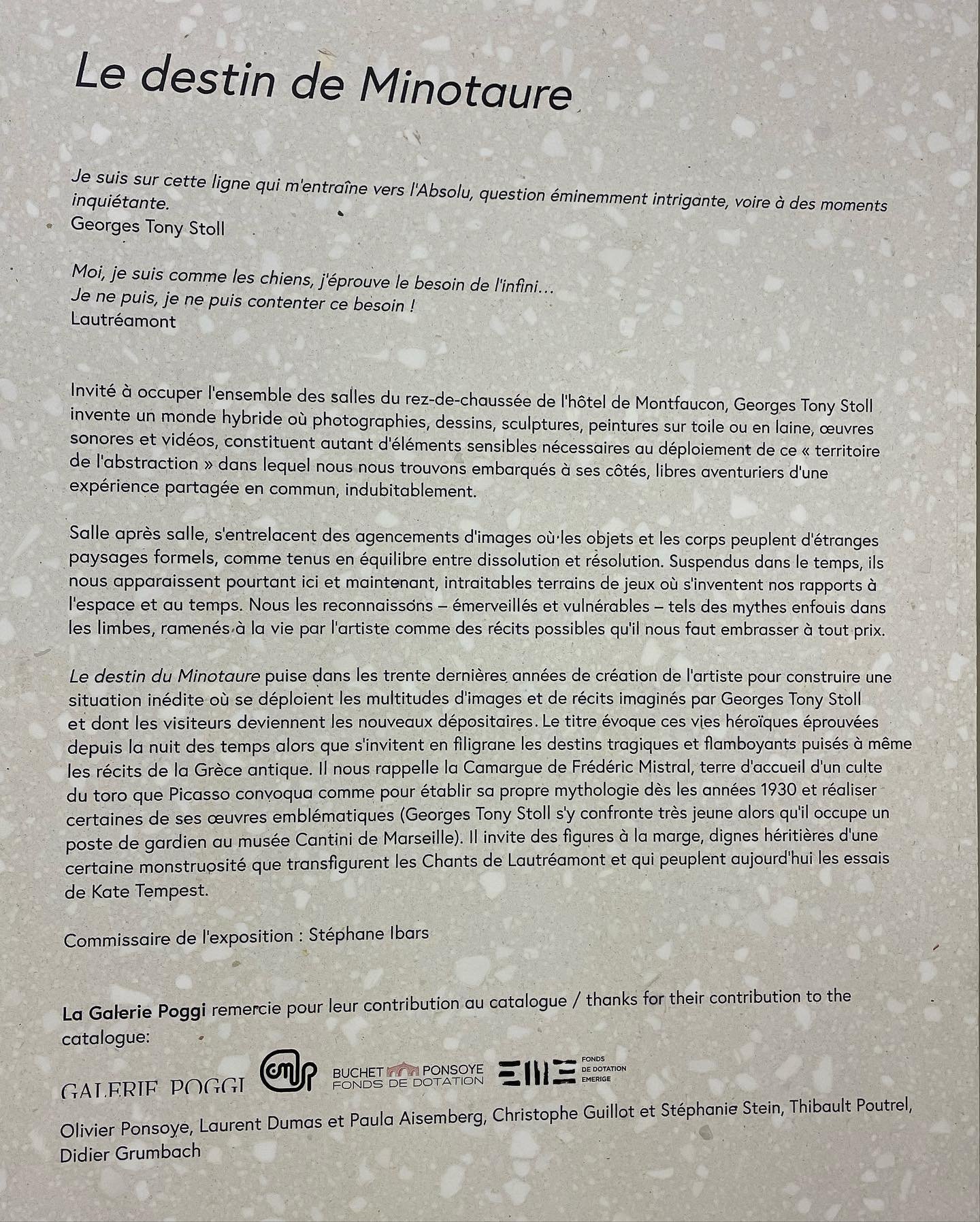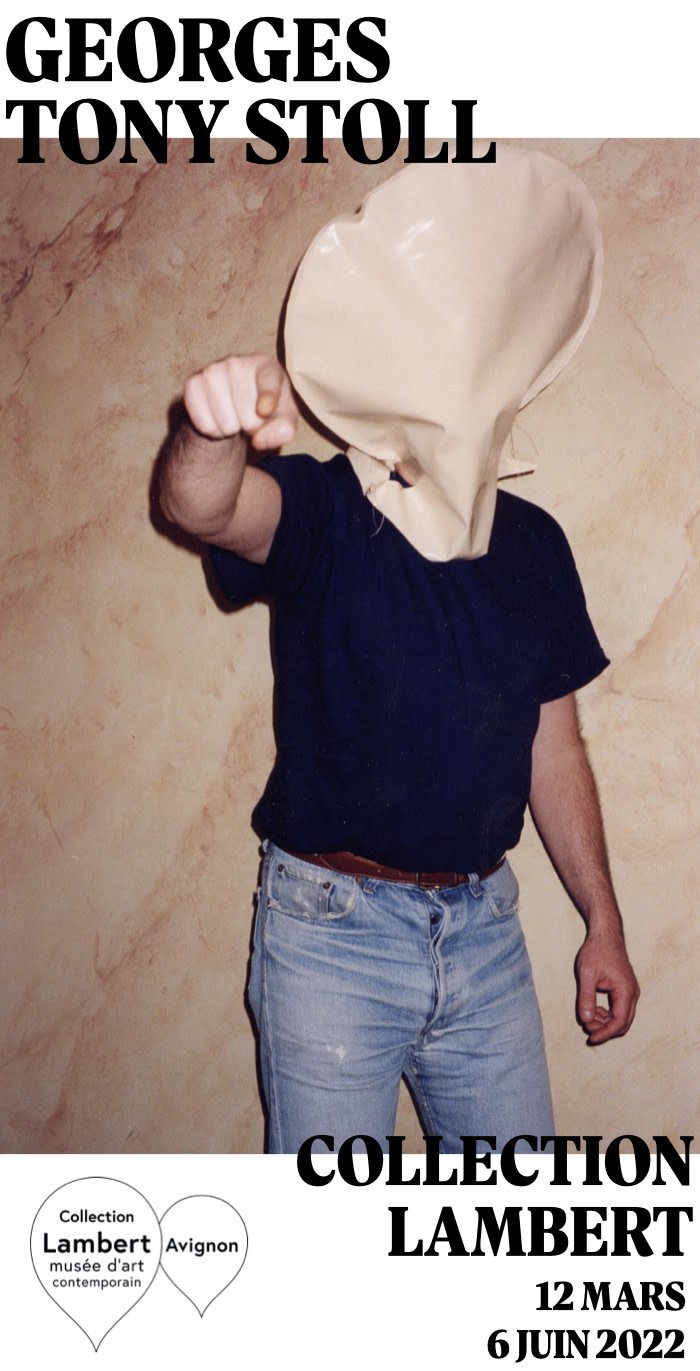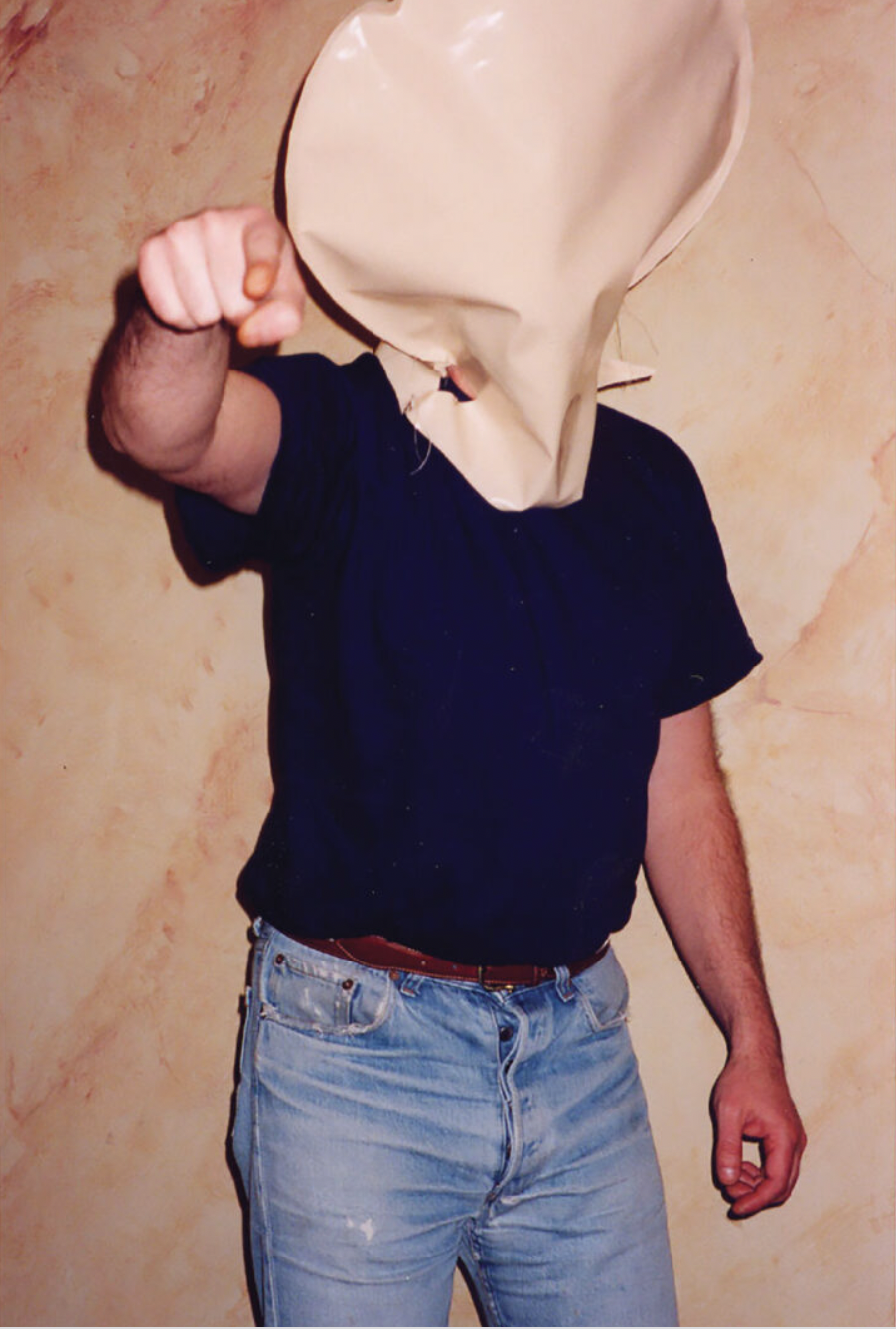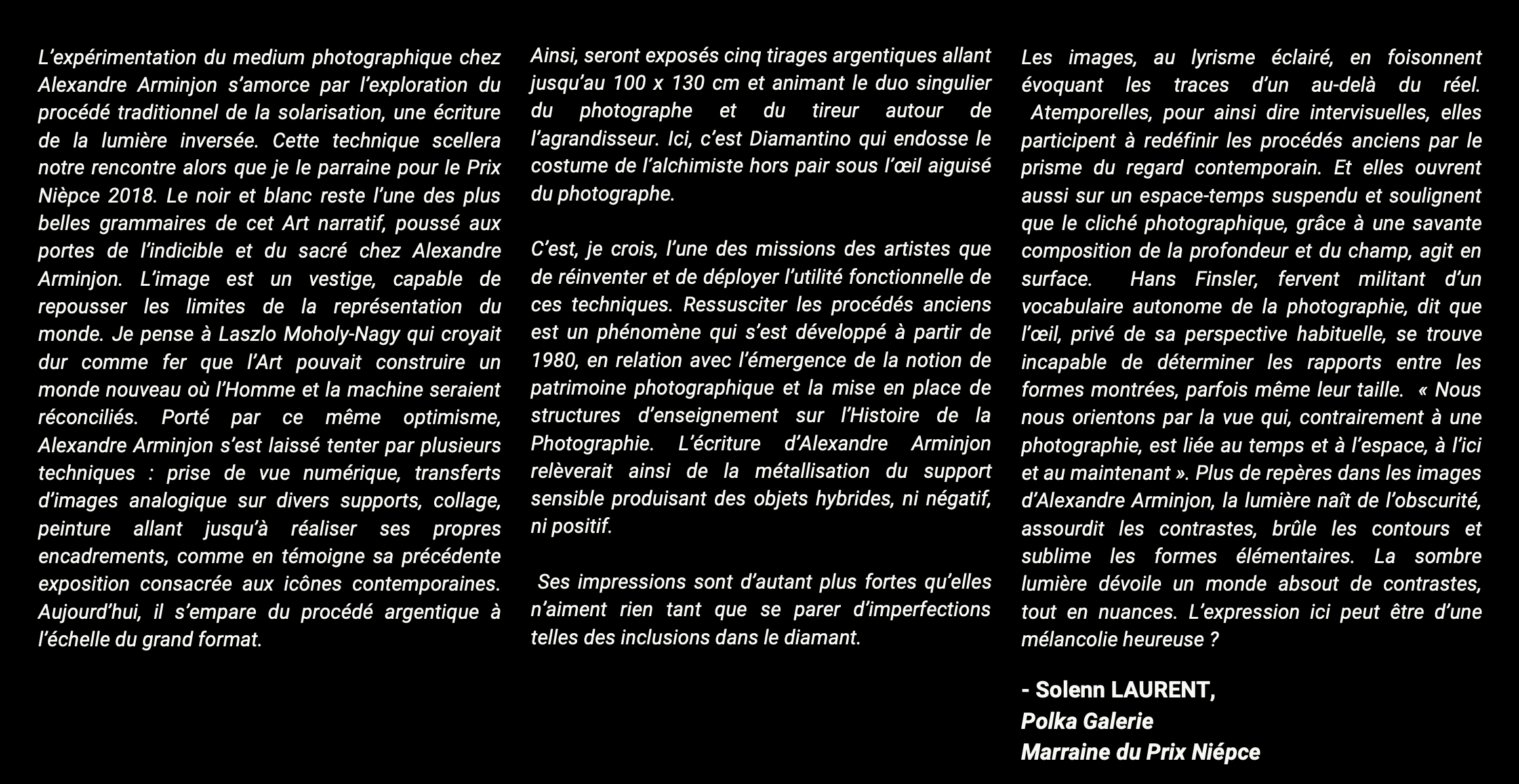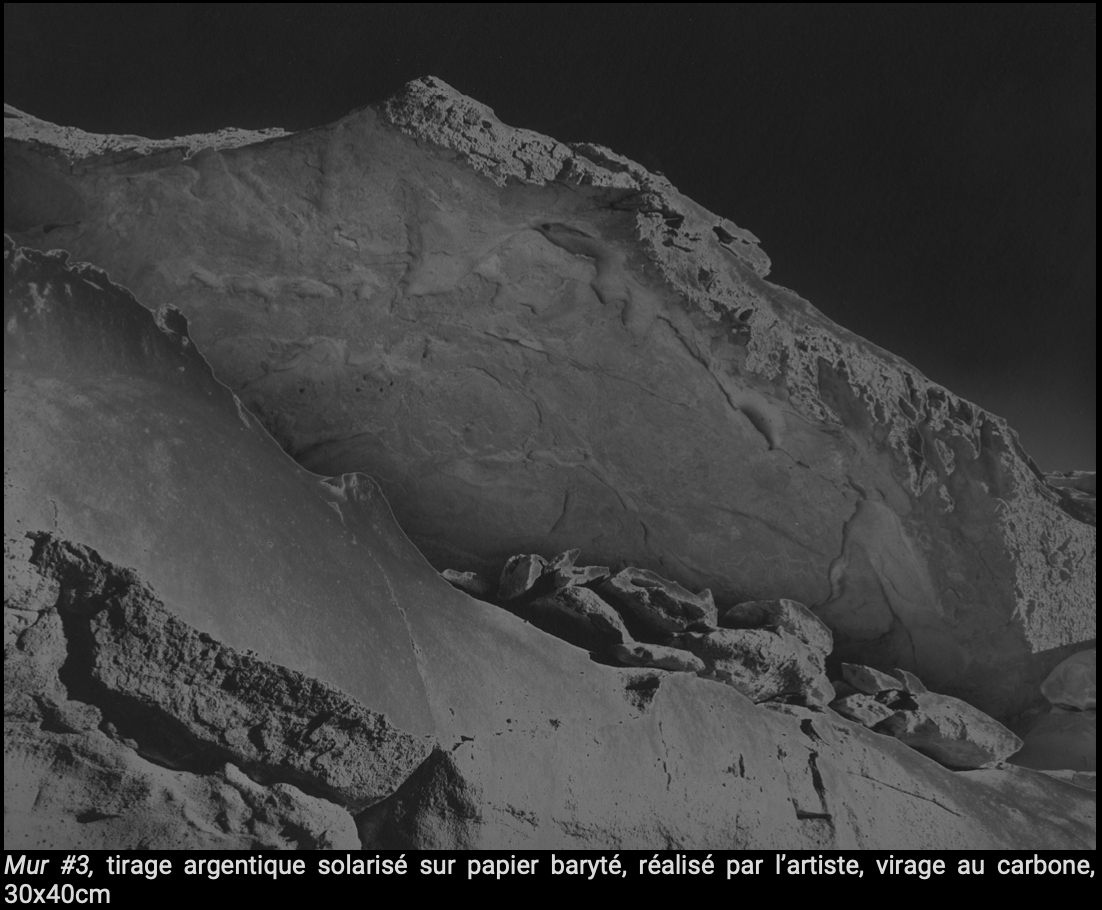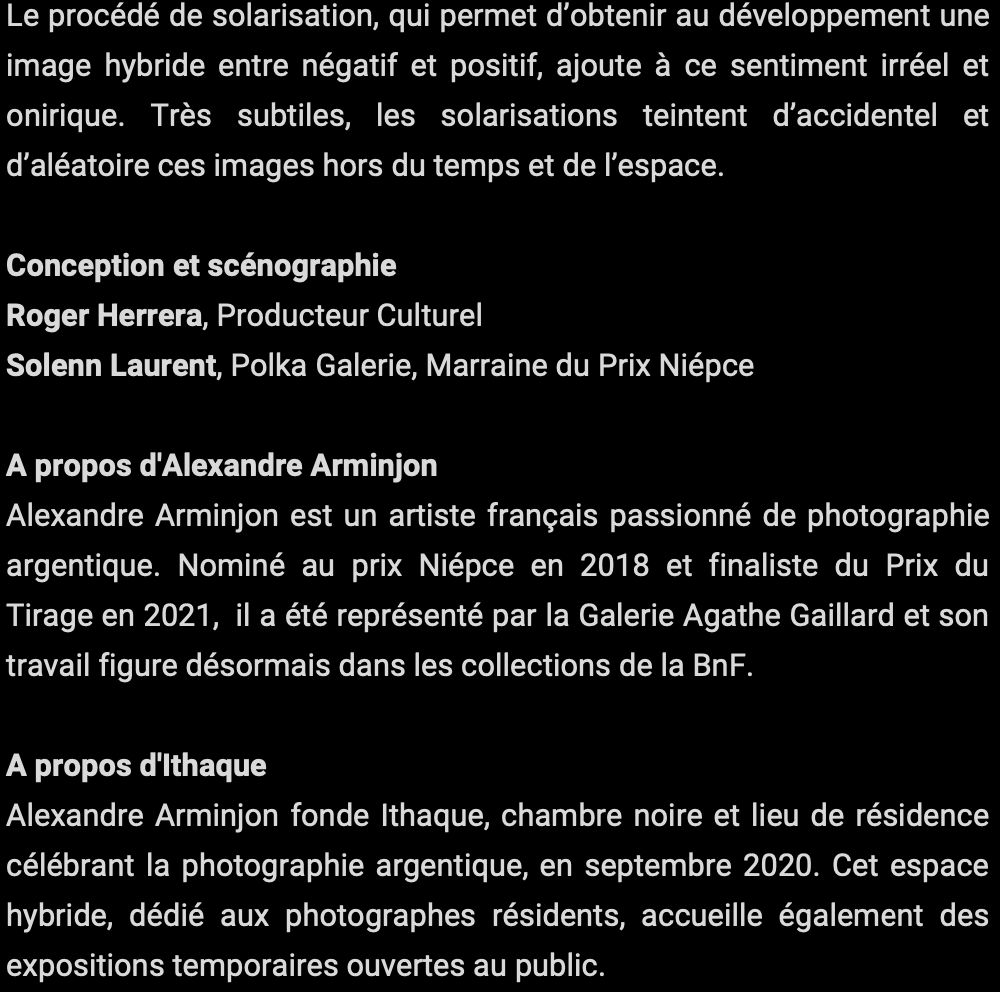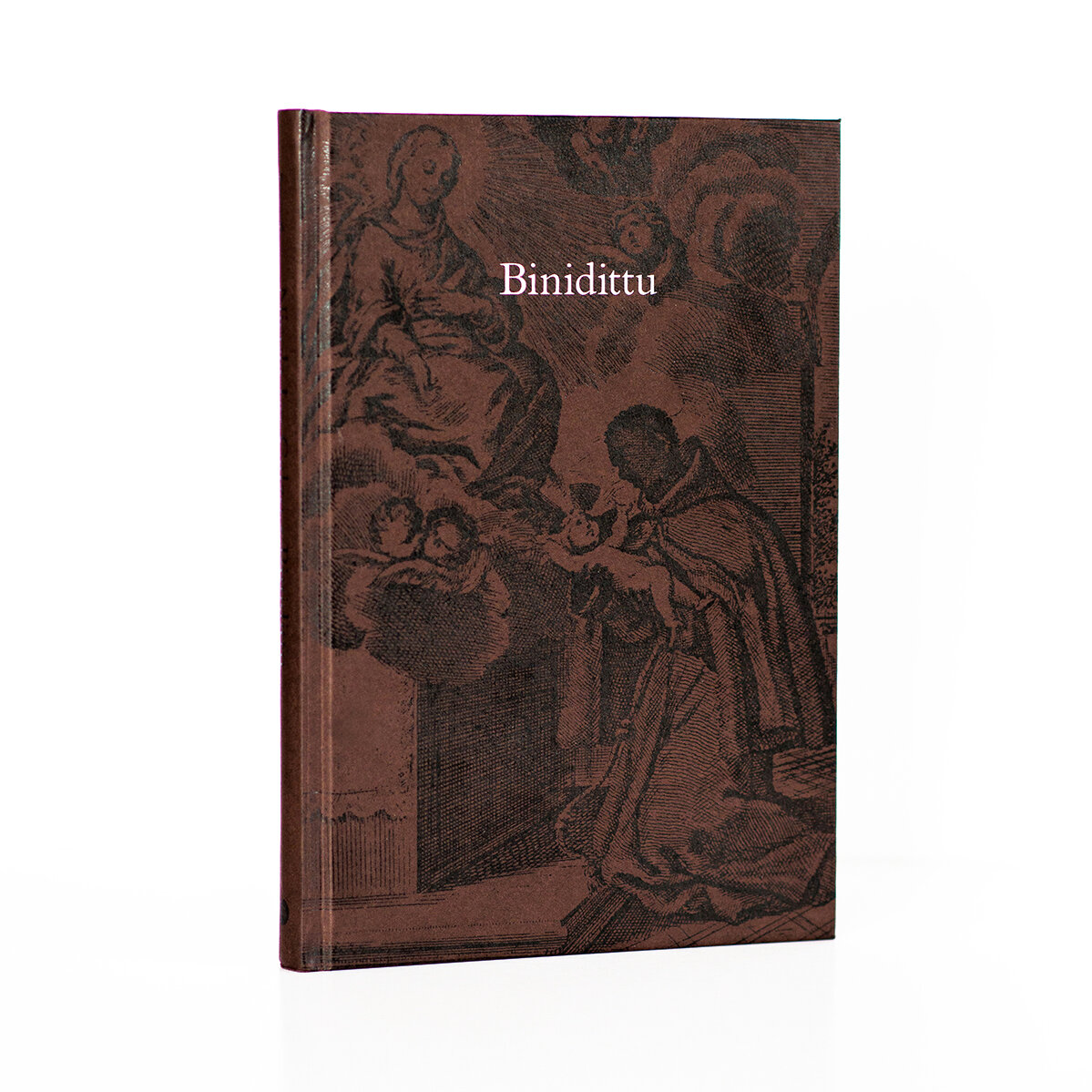CUBA TALKS
Auteurs : Laura Salas Redondo, Jérôme Sans
Année : 2018
Cuba Talks est le premier livre d’envergure explorant la scène artistique contemporaine cubaine depuis les années quatre-vingt. A travers une série de textes et d’entretiens explorant les démarches de trente artistes issus de deux générations différentes, Cuba Talks dresse un large panorama signifiant d’un contexte créatif encore complexe à appréhender.
C’est en croisant leurs deux visions – internes et externes à la culture cubaine – que Laura Salas Redondo et Jérôme Sans ont sélectionné les artistes réunis dans ce livre. Autant de personnalités à qui il est donné d’entendre la voix. Au-delà de la mise en lumière d’une communauté de créateurs, leurs approches singulières démontrent une effervescence artistique unique qui résonne au-delà des frontières de Cuba.
Le livre, de plus de 300 pages, sera illustré d’une importante sélection d’œuvres, créant un volume exceptionnel dédié à l’étude et à une meilleure compréhension d’une scène artistique encore méconnue à l’échelle internationale.
Cuba Talks offre un nouveau regard sur une scène plurielle et résolument engagée dans le débat de la culture cubaine et internationale contemporaine.
ARTISTES :
Abel BARROSO, 1971, Pinal del Río
Tania BRUGUERA, La Habana, 1968
Alejandro CAMPINS, 1981, Manzanillo
Elizabet CERVIÑO, 1986, Manzanillo
Iván CAPOTE, 1973, Pinar del Río
Yoan CAPOTE, 1977, Pinar del Río
Los Carpinteros (Dagoberto RODRÍGUEZ, Caibarién, 1971 & Marcos CASTILLO, Camagüey, 1971)
Celia & Yunior (Celia GONZÁLEZ, 1985 La Habana & Yunior AGUIAR, La Habana, 1984)
Susana PILAR, La Habana, 1984
Leandro FEAL, 1986, La Habana
Diana FONSECA, La Habana, 1978
Carlos GARAICOA La Habana, 1967
Flavio GARCIANDIA, Caibarién, 1954
Osvaldo GONZÁLEZ, 1982, Camagüey
Hamlet LAVASTIDA, La Habana 1983
Glenda LEÓN, 1976, La Habana
Alexis LEYVA (a.k.a. KCHO), Nueva Gerona, 1970
Reynier LEYVA NOVO, (a.k.a. Chino), 1983, La Habana
Luis LÓPEZ-CHÁVEZ (a.k.a. Chinito), 1988, Manzanillo
Carlos MARTIEL, La Habana, 1989
Yornel MARTÍNEZ, 1981, Manzanillo
Adrian MELIS 1985, La Habana
José MESÍAS, La Habana, 1990
José PARLA, Miami, 1973
Michel PÉREZ (a.k.a. El Pollo), Manzanillo, 1981
Eduardo PONJUAN , Pinar del Rio, 1956
Wilfredo PRIETO, 1978, Sancti Spiritu
Lazaro SAAVEDRA, La Habana, 1964
René Francisco RODRÍGUEZ, Holguín, 1960
José YAQUE, 1985, Manzanillo